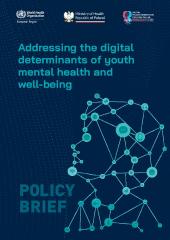|
La conférence internationale qui s’est déroulée à Paris, les 16 et 17 juin derniers, S’y mettre tous Pour s’attaquer effectivement aux déterminants de la santé mentale, la mobilisation doit être générale, comme l’ont rappelé plusieurs intervenants. Anahit Avanesyan, Ministre de la santé d’Arménie, a trouvé une punchline reprise notamment par ses homologues Estonien et Lituanien : "Pas besoin d’une armée de psychologues, mais que toute la société s’y mette !".La formule traduit bien la maturité d’une réflexion qui amène de nombreux pays à rendre moins sanitaire qu’auparavant un enjeu devenu sociétal, avec une nécessaire impulsion législative.En Arménie, cela s’est traduit par la mise en œuvre d’un large programme de formation des enseignants, des travailleurs sociaux et des médecins généralistes. Implémenter Thomas Linden (Suède) l’affirme : sans stratégie claire d’implémentation, cela ne marche pas. La mise en place de comités de mise en œuvre des stratégies dans toutes les politiques ont souvent été évoqués. Michelle Funk a rappelé la démarche proposée par l’OMS en plusieurs étapes : initier un dialogue gouvernemental pour développer des plans d’action ; réviser les politiques et stratégies existantes ; créer une équipe intégrant des profils variés pour la mise en œuvre ; imaginer de nouveaux contenus politiques ; consulter largement ; aller vers l’implémentation ; mesurer les progrès réalisés. L’interministériel à la française Une large place aux initiatives française aura été faite lors de cet événement. Et la mobilisation gouvernementale est à remarquer : outre le ministre de la santé et le délégué ministériel, Franck Bellivier - très impliqué dans l’organisation – les intervenants du CCOMS et autres intervenants français, ce ne sont pas moins de cinq ministres délégués ou secrétaires d’Etat qui étaient présents. Juliette Méadel, a rappelé que la politique de la Ville est éminemment interministérielle, "…le premier facteur de la santé mentale étant la précarité sociale". Jérôme d'Harcourt, Délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement, a rappelé que le programme « un logement d’abord » a complètement changé la manière de travailler, la baisse des hospitalisations et surtout le maintien dans l’habitat de personnes avec des troubles psychiques importants ayant prouvé que l’on ne peut préjuger de la capacité des personnes à se maintenir dans un logement. Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'Autonomie et du Handicap aura pour sa part insisté sur la prévention de l’isolement "…un chantier pour l’ensemble du gouvernement", les programmes d’activités culturelles ou d’activité physique adaptée dans les établissements d’hébergement pour les personnes âgées, ou le programme de prévention de perte d'autonomie Icope. Echelon local Les acteurs locaux n’étaient pas absents des débats. Leur agilité et leur capacité d’innovation ont une fois de plus été valorisées, avec le travail d’"aller-vers" les publics vulnérables mené à Cologne, l’approche intersectorielle développée à Barcelone depuis 2015 avec un axe prévention fort, ou encore l’articulation entre urbanisme, éducation, santé publique, et engagement communautaire à Ultrecht (Pays-Bas). Le modèle français des Conseils locaux de santé mentale a été présenté par Fanny Pastant (CCOMS). Karine Bui Xuan Piccedda, adjointe au maire d’Annecy, a alerté sur la fragilité de ces derniers, rappelant qu’ils dépendent fortement de la volonté politique locale. Elle a plaidé pour leur pérennisation et leur financement. Jeunes Partout en Europe, les jeunes sont en forte demande de soins, et l’offre psychiatrique ne peut répondre. Or, certaines personnes n’ont pas besoin de diagnostic, mais simplement d’un lieu ou d’une personne à qui parler. Au Danemark, “Headspace”, inspiré de l’Australie, offre une approche non-clinique et des interventions précoces en termes de prévention et promotion de la santé auprès des 12-25 ans. Il s’agit de lieux accessibles, gratuits et sans liste d’attente. Il existe 38 centres dans 36 villes. En Espagne, une ambitieuse stratégie a été déployée pour que les jeunes puissent dire ce qu’ils pensent des lois qui les concernent. Suicide Lors de la session sur la prévention du suicide, la présentation de stratégies et dispositifs nationaux de Chypre, d’Irlande, de Malte et de France a mis en avant la nécessité d'une élaboration et d'un déploiement au-delà du secteur de la santé. Cela implique des interventions et outils à l'intersection de différents domaines, secteurs et niveaux impliquant une diversité d’acteurs (comme l'agriculture, l'éducation, la justice) afin de faire de la prévention du suicide l'affaire de tous. Le témoignage de Živilė Valuckienė, membre du Global Mental Health Peer Network, a souligné l’importance du respect des droits humains et d'un rétablissement fondé sur la pair-aidance et le lien social dans l'accompagnement proposé aux personnes concernées. Emploi La santé mentale devrait faire partie intégrante de la santé au travail. Plusieurs initiatives en Tchéquie, Hongrie, Finlande, France et Belgique vont dans ce sens. Or, une part importante des personnes en incapacité de travail de longue durée le sont pour des raisons de santé mentale. Elles sont 30% en Belgique par exemple. Si la réadaptation socio-professionnelle ne se limite pas au retour au travail, quelques pistes d’action ont été évoquées : trouver des moyens de mesurer la santé mentale au travail ; soutenir la formation en matière de santé mentale au travail ; soutenir les employés ayant des problèmes de santé mentale afin qu'ils puissent réintégrer le marché du travail ; axer les initiatives sur le respect et l’estime, l’équité, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les relations interpersonnelles ; s’appuyer sur les experts d’expérience pour aider à la réintégration sur le marché du travail. Ukraine De nombreuses interventions auront permis à la fois de mesurer à quel point les paysde l’Est (Estonie, Tchéquie, Pologne…) accueillent massivement des réfugiés en demande de soin, les stratégies mises en places par les pays d’accueil, et surtout, la résilience du système de santé mentale en Ukraine, alors que 80% de la population souffre de stress et d’anxiété suite à l’invasion russe. Enfin, la conférence aura permis l’engagement symbolique, mais solennel, des participants, à poursuivre leurs efforts, en signant une déclaration commune.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retrouvez les 10 précédentes éditions de la Lettre du GCS ici. Copyright © 2025, tous droits réservés. La Lettre du Groupement de coopération sanitaire pour la recherche et la formation en santé mentale est éditée par le Centre collaborateur de l'OMS (CCOMS), service de l’EPSM Lille métropole. Le GCS a pour objet la recherche, la formation et la mise en œuvre d’actions visant le développement de dispositifs de santé mentale intégrés dans la cité, incluant la prévention et l’insertion des publics souffrant de troubles mentaux. Le Groupement œuvre à la promotion des échanges professionnels et à toute action de lutte contre la stigmatisation en santé mentale et en psychiatrie. Il favorise et soutient la participation des représentants des usagers, des familles et des aidants. Le GCS, dont le conseil scientifique est celui du CCOMS de Lille, relaie les recommandations de l’OMS au niveau national et localement. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant que vous pouvez exercer en envoyant un e-mail à alain.dannet@ghtpsy-npdc.fr. |
 co-organisée par l’OMS Europe et le Ministère français de la Santé et de l’Accès aux soins, en partenariat avec le CCOMS de Lille, a réuni près de 300 participants provenant de 33 pays, parmi lesquels figuraient une quinzaine de Ministres, Vice-ministres et Secrétaires d’Etat.Elle est issue d’une série inédite de dialogues politiques menés par l’OMS à travers la région européenne. Ces dialogues ont révélé un message fort : les pays sont prêts à décloisonner leurs politiques publiques, à partager des solutions et à travailler ensemble pour repenser la santé mentale comme une responsabilité partagée entre tous les secteurs - au-delà du seul secteur de la santé - impliquant toutes les composantes de la société.
co-organisée par l’OMS Europe et le Ministère français de la Santé et de l’Accès aux soins, en partenariat avec le CCOMS de Lille, a réuni près de 300 participants provenant de 33 pays, parmi lesquels figuraient une quinzaine de Ministres, Vice-ministres et Secrétaires d’Etat.Elle est issue d’une série inédite de dialogues politiques menés par l’OMS à travers la région européenne. Ces dialogues ont révélé un message fort : les pays sont prêts à décloisonner leurs politiques publiques, à partager des solutions et à travailler ensemble pour repenser la santé mentale comme une responsabilité partagée entre tous les secteurs - au-delà du seul secteur de la santé - impliquant toutes les composantes de la société.
 Le pays a ainsi entamé une réforme profonde de son système, passant d’un modèle hospitalo-centré à une approche plus communautaire. Les services sont déployés au plus près des populations, avec une logique d’"aller-vers". Des acteurs de tous horizons (instituteurs, artistes, professionnels de santé primaire, privé) sont mobilisés pour offrir un soutien psychosocial de proximité. L’objectif est clair : n’exclure personne, où qu’il soit.
Le pays a ainsi entamé une réforme profonde de son système, passant d’un modèle hospitalo-centré à une approche plus communautaire. Les services sont déployés au plus près des populations, avec une logique d’"aller-vers". Des acteurs de tous horizons (instituteurs, artistes, professionnels de santé primaire, privé) sont mobilisés pour offrir un soutien psychosocial de proximité. L’objectif est clair : n’exclure personne, où qu’il soit.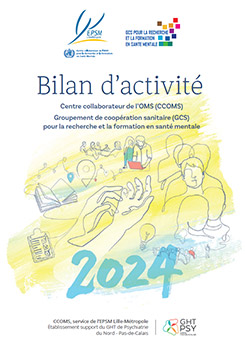
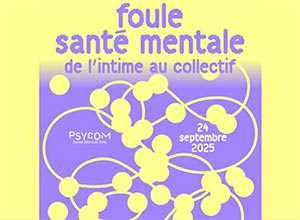 "Foule santé mentale : de l’intime au collectif". La perte de repères, l'accélération de la vie numérique et la polarisation des opinions empêchent souvent de penser la complexité et de faire face aux incertitudes. La journée Psycom propose d'interroger les interactions entre l’individu et la société dans les problématiques de santé mentale. Des intervenantes et intervenants variés échangeront autour de trois thématiques : prendre soin et soigner, informer ou désinformer, stigmatiser ou déstigmatiser. Elle se tiendra le 24 septembre au ministère de la Santé.
"Foule santé mentale : de l’intime au collectif". La perte de repères, l'accélération de la vie numérique et la polarisation des opinions empêchent souvent de penser la complexité et de faire face aux incertitudes. La journée Psycom propose d'interroger les interactions entre l’individu et la société dans les problématiques de santé mentale. Des intervenantes et intervenants variés échangeront autour de trois thématiques : prendre soin et soigner, informer ou désinformer, stigmatiser ou déstigmatiser. Elle se tiendra le 24 septembre au ministère de la Santé.