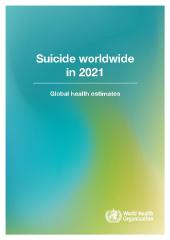|
Voir la version en ligne.
|
 |
 Dr René Keet, Dr René Keet,
Président du Réseau européen des services de santé mentale dans la communauté (EUCOMS - European Community based Mental Health Service Providers Network)
Service de santé mentale dans la communauté GGZ Noord-Holland-Noord
"Les communautés sont un facteur clé pour favoriser la bonne santé mentale"
Qu’est-ce qu’EUCOMS ?
"Depuis 2016, EUCOMS est un réseau international de services de santé mentale qui travaillent ou souhaitent travailler dans la communauté.  Nous apprenons les uns des autres grâce à l’échange de pratiques. EUCOMS compte plus de 30 services membres, de la Norvège au Portugal et de l’Irlande à l’Ukraine. Nous organisons deux rencontres par an en Europe, qui nous permettent d’effectuer des visites d’étude et de découvrir comment les services fonctionnent en pratique. En plus de ces rencontres, nous organisons 4 webinaires par an sur un thème spécifique à la santé mentale dans la communauté. Chacun d’entre eux est introduit et conclu par des experts d’expérience et des performances musicales en live. Enfin, nous éditons une newsletter mensuelle." Nous apprenons les uns des autres grâce à l’échange de pratiques. EUCOMS compte plus de 30 services membres, de la Norvège au Portugal et de l’Irlande à l’Ukraine. Nous organisons deux rencontres par an en Europe, qui nous permettent d’effectuer des visites d’étude et de découvrir comment les services fonctionnent en pratique. En plus de ces rencontres, nous organisons 4 webinaires par an sur un thème spécifique à la santé mentale dans la communauté. Chacun d’entre eux est introduit et conclu par des experts d’expérience et des performances musicales en live. Enfin, nous éditons une newsletter mensuelle."
Qu’entendez-vous par communauté et quels sont les critères pour faire partie de ce réseau ?
"La communauté, c’est le contexte social dans lequel chacun de nous vit. Cela peut inclure le voisinage, votre travail, un engagement associatif, une activité culturelle, un club de sport… Il s’agit du groupe de personnes que chacun côtoie et auquel il se sent connecté, contribuant pour une bonne part à son bien-être. Désormais, avec les nouveaux outils digitaux, des e-communautés se sont développées. Il existe donc deux types de communautés : physique et virtuelle. Nous sommes des créatures sociales, c’est pourquoi les communautés sont un facteur clé pour favoriser la bonne santé mentale. Pendant très longtemps, nous avons créé des communautés à part pour les personnes souffrant d’un trouble psychique, ce qui a eu pour conséquence de couper ces personnes de leur propre communauté, celle d’où ils viennent ou celle qu’ils se sont choisie. C’est ce qui nous a amenés à définir, pour EUCOMS, 6 principes que les membres ont en commun."
Quels sont ces principes ?
"Tenter de définir "le" modèle parfait pour un service de santé mentale dans la communauté afin de l’implanter partout serait un peu comme essayer de planter un arbre dans un environnement qui ne serait pas le sien. Cela n’est pas si simple, car chaque contexte territorial est différent. C’est pourquoi nous avons souhaité définir des principes communs. Ces principes sont : Droits de l’Homme ; Santé publique ; Rétablissement ; Efficacité ; Réseau ; Expertise d’expérience.
Le respect des droits des personnes confrontées à un trouble psychique est un des sujets qui me motive le plus, car nous pouvons faire bien mieux, qu’il s’agisse des mesures de contrainte, de l’accès à l’emploi ou du droit à des soins somatiques de qualité pour avoir la même espérance de vie que la population générale.
Les professionnels de la santé mentale sont formés à prodiguer des soins individualisés. Or nous devons nous intéresser à l’environnement et au contexte social. C’est pourquoi nous devons davantage adopter une approche de santé publique. Je suis d’ailleurs ravi à ce propos du thème du prochain congrès à Lille*.
Concernant le rétablissement, qui démarre du mouvement d’usagers qui n’acceptaient plus de ne pas être traités comme des citoyens, les témoignages de parcours de rétablissement nous rendent humbles en tant que soignants, car ils montrent bien à quel point il est important de donner de l’espoir et de soutenir le développement personnel, les souhaits, les talents, les objectifs, plutôt que de nous focaliser sur la réduction des symptômes.
Le sujet de l’efficacité nous amène à la recherche de preuves scientifiques. Dans sa pratique, le clinicien doit combiner ces preuves avec les valeurs et les objectifs du patient et tenir compte de l’approche rétablissement. L’efficacité et le rétablissement ne sont pas comme l’huile et l’eau, insolubles, ils peuvent être combinés comme l’huile et le vinaigre. Mais cela implique un nouveau type de recherche pour définir les preuves, la recherche-action en particulier, construite avec des experts d’expérience, qui, pour certains, deviendront eux-mêmes chercheurs.
Pour la notion de réseau, cela rejoint la définition donnée plus haut de la communauté : dans une approche en réseau, le service de santé mentale n’agit pas seul, il devient un membre de cette communauté, avec un poids égal à celui des autres. Il y a bien des chemins vers le rétablissement qui se passent de notre intervention.
Enfin, l’expertise d’expérience est, dans notre vision, la troisième source d’expertise après la science et la pratique (incluant l’intervision, la supervision). L’expertise d’expérience commence en ayant vécu un trouble de santé mentale. S’en suit une réflexion sur cette expérience pour qu’elle devienne un savoir. Elle devient une compétence professionnelle après avoir suivi une formation."
Quelles pratiques remarquables avez-vous pu identifier ?
"Je vais vous donner quelques exemples, en sachant qu’il existe beaucoup d’autres expériences très intéressantes, mais je ne peux pas toutes les citer ici.
Ce n’est pas parce que vous m’interviewez, mais l’exemple que je donne à chaque fois concernant les droits de l’Homme est celui de Lille. Je crois que l’approche de l’OMS avec le programme QualityRights est importante car elle dit qu’une pratique respectueuse des droits peut faire l’objet de formations. On passe d’idées abstraites à un outil concret, et c’est ce que le CCOMS fait en France.
Pour la santé publique, l’exemple que je voudrais valoriser ici vient d’Ukraine, où il se passe quelque chose de remarquable : en pleine guerre, le pays a, sous l’impulsion de la première dame, Olena Zelenska, décidé de réformer son système de soins en santé mentale. Ils auraient pu reléguer ce sujet au second plan, mais ils en ont fait une priorité. J’ai visité plusieurs fois les hubs créés à l’Ouest du pays pour les vétérans, dans lesquels il y a également nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Les vétérans organisent eux-mêmes ces endroits, situés dans des bâtiments mis à disposition par les municipalités, dans lesquels la pair-aidance est de mise pour les blessures à la fois physiques et mentales. Lorsqu’un soutien psychologique est nécessaire, ils font appel au système de soins communautaires qui envoie un professionnel dans le hub. C’est donc l’inverse de la plupart des systèmes de soins où les professionnels sont regroupés et invitent les usagers à venir les voir. Cela me semble être un bon exemple en termes de santé publique.
Concernant le rétablissement, je citerais le service dans lequel j’exerce aux Pays-Bas (GGZ Noord-Holland-Noord). Dans ce service, la philosophie du rétablissement concerne tout le monde, quelles que soient les unités (mobiles, de long-terme, logement accompagnés, soins intensifs, etc.) ou les pathologies. C’est devenu un langage commun. Nous avons développé la prise en charge axée sur le rétablissement, et ce dès le premier rendez-vous (pas seulement lorsque la situation s’est chronicisée). Les évaluations de ce fonctionnement sont positives, donc je pense que l’on peut parler de bonne pratique.
Lorsque l’on évoque l’efficacité, je pense à une expérience vue en Moldavie, un petit pays situé à l’Est de l’Europe, dont le système de soin est hérité de l’époque soviétique, avec trois grands hôpitaux psychiatriques. Ils ont désormais développé des équipes de soins de santé mentale dans la communauté. Cette nouvelle organisation a fait l’objet d’une recherche évaluative qui a démontré son efficacité. Nous devons systématiquement évaluer les réformes entreprises et c’est ce qui a été fait en Moldavie, ce qui est un exemple pour nous tous.
Pour l’approche en réseau, il y a beaucoup de bonnes pratiques, par exemple à Londres, où la collaboration entre la NHS et les ONG locales est remarquable. Aux Pays-Bas également, le travail en réseau est de plus en plus considéré, depuis une dizaines d’années, sous la forme d’écosystèmes, dans lesquels chacun a un rôle à jouer.
Enfin, concernant la pair-aidance, je voudrais citer l’exemple Norvégien, où une association nationale de pair-aidants experts a été créée. Elle fait un travail exceptionnel."
|
*Rencontrez les membres du réseau EUCOMS lors des sessions internationales du congrès de la Société française de santé publique, qui se tiendra à Lille des 5 au 7 novembre 2025.
En 2026, les prochaines rencontres EUCOMS auront lieu à Zamora (Espagne) en avril et à Utrecht et Leyde (Pays-Bas) en septembre.
Si vous souhaitez devenir membre du réseau EUCOM, contactez : info@eucoms.net. En savoir plus : https://eucoms.net/
|
 |
 OMS : Les pairs aidants en France, l’expérience vécue, domaine d’expertise en matière de soins de santé mentale OMS : Les pairs aidants en France, l’expérience vécue, domaine d’expertise en matière de soins de santé mentale
L'article publié sur le site de l'OMS valorise le programme des Médiateurs de santé pairs du CCOMS à travers le témoignage de Freya. Les médiateurs de santé pairs comme Freya ne sont ni membres du personnel médical, ni usagers de soins : ils se situent quelque part entre les deux. Les médiateurs de santé pairs suivent une formation d’un an qui fait partie d’un programme universitaire de premier cycle, conçu par le CCOMS de Lille et 2 universités françaises (Bordeaux et Sorbonne Paris Nord). La grille des cours est basée sur un programme existant pour les sciences sociales, comprenant des cours de psychologie, sur la santé et les migrations, le droit et l’anthropologie, avec, en plus, des cours sur les systèmes de santé mentale et la psychiatrie, ainsi que sur des compétences pratiques telles que l’animation de groupe. Il s’agit également d’utiliser l’expérience vécue de manière professionnelle et éthique. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe soutient activement le travail des pairs aidants et d’autres formes de savoir expérientiel. Dans le cadre de son accord de collaboration avec la Commission européenne, baptisé "Relever les défis de la santé mentale dans l’Union européenne, en Islande et en Norvège", une nouvelle feuille de route a été publiée. Elle propose aux pouvoirs publics et aux décideurs des mesures concrètes pour intégrer le savoir expérientiel dans la politique, les services et les communautés de santé mentale. Depuis 2012, plus de 200 postes de Médiateurs de santé pairs ont été créés dans le cadre du programme national lancé par le CCOMS.
A lire ici.
|
 Du savoir expérientiel au partenariat : l’alliance des savoirs Du savoir expérientiel au partenariat : l’alliance des savoirs
Le savoir expérientiel des personnes vivant avec un trouble psychique, longtemps marginalisé, s’impose aujourd’hui comme un levier essentiel pour transformer les pratiques en santé mentale. À travers une analyse conceptuelle et phénoménologique, l’article publié dans l’Information psychiatrique de juin-juillet 2025 explore sa construction et son articulation avec les savoirs des professionnels. En s’appuyant sur les notions de réceptivité et d’accordage, il partage le cheminement par lequel une expérience individuelle peut devenir un savoir pour le collectif, impliquant un travail réflexif, narratif et collaboratif. Enfin, il interroge les conditions d’un partenariat authentique, ancré dans la reconnaissance mutuelle et le dialogue, afin de promouvoir une approche pluraliste des défis complexes de la santé mentale. Cet article en "Open access" fait partie d’un dossier sur les savoirs expérientiels, coordonné par le Dr J-L. Roelandt (CCOMS) et P. Desmons, à découvrir dans le même numéro.
|
 Congrès SFSP : du 5 au 7 novembre, rendez-vous à Lille ! Congrès SFSP : du 5 au 7 novembre, rendez-vous à Lille !
Le prochain congrès de la Société Française de Santé Publique aura pour thème "Santé mentale publique". Ce congrès est un événement généraliste en santé publique auquel sont invitées à participer l’ensemble des communautés professionnelles et scientifiques (chercheurs, acteurs de l’intervention, institutions, etc.), ainsi que les acteurs non-professionnels de santé publique, œuvrant ou contribuant au champ de la santé publique : élus, habitants, citoyens, etc. Co-organisée avec le CCOMS, cette édition accueillera les journées nationales des CLSM et de nombreuses autres communications sur le thème de la santé mentale, y compris les trois plénières. En outre, et pour la première fois dans le cadre de ce congrès, un programme international donnera la part belle au partage de connaissances et d’expériences pour l’amélioration des pratiques, en particulier en matière de soins de santé mentale dans la communauté.
Consultez le programme et inscrivez-vous ici.
|

|
 DIU "Santé mentale dans la communauté" 2026 : inscrivez-vous ! DIU "Santé mentale dans la communauté" 2026 : inscrivez-vous !
Le Diplôme Inter-Universitaire "Santé mentale dans la communauté : étude et applications" propose une formation théorique et pratique à la santé mentale dans la communauté et à ses applications dans les domaines suivants : organisation des services dans la cité, développement des pratiques psychiatriques centrées sur le rétablissement, promotion et prévention de la santé mentale, lutte contre la stigmatisation et la discrimination, participation des élus locaux, des usagers et des aidants aux dispositifs de prévention, de soins et d’insertion sociale. Proposée par les Universités de Lille et Paris 13, l’AP/HM, le CHU Sainte Marguerite de Marseille et le CCOMS de Lille, l'édition 2026 aura lieu en mars, juin et septembre, à Paris, Lille et Marseille, sur un volume horaire de 121 heures. Les méthodes pédagogiques utilisées comprendront des cours théoriques, des études de cas et analyses de pratiques, des tables rondes et débats, des visites de services et rencontres d’équipes et des professionnels des collectivités territoriales, des services de l’État, des universitaires, des usagers et associations de familles en santé mentale.
En savoir plus, consulter le programme…
Contact : ccoms@ghtpsy-npdc.fr
|
 Nouvel article sur le programme QualityRights Nouvel article sur le programme QualityRights
La revue Santé Mentale consacre son dernier numéro à la formation et y publie un article sur l’expérience des observateurs QualityRights. En s’appuyant sur une étude qualitative, cet article explore le vécu des participants aux observations QualityRights et analyse l'influence de ces immersions sur les représentations et les pratiques de soins. Accédez gratuitement à l'article : Droits des usagers : "QualityRights redonne du sens à ma pratique".
|
 La charte du collectif DAP accessible en ligne La charte du collectif DAP accessible en ligne
Afin de garantir la réussite du déploiement effectif et coordonné des Directives Anticipées en Psychiatrie (DAP), un collectif national s’est constitué (dont le CCOMS est membre), composé de personnes qualifiées, associations et institutions investies dans le déploiement des DAP en France. Un comité de pilotage anime ce collectif. Afin de permettre son bon fonctionnement, le collectif a rédigé une charte intégrant les principes et certaines valeurs liés aux DAP partagés et défendus collectivement. Il est attendu que tous les membres du collectif s’engagent à respecter et à mettre en œuvre cette charte, au service tout d’abord des personnes concernées par les troubles psychiques et dans l’intérêt commun.
A lire ici.
|
 |
 3 nouveaux rapports parlementaires sur la santé mentale 3 nouveaux rapports parlementaires sur la santé mentale
Le 25 juin, la commission des affaires sociales du Sénat a présenté, par la voix de son président Philippe Mouiller et des rapporteurs Jean Sol, Daniel Chasseing et Céline Brulin, un rapport intitulé "Santé mentale et psychiatrie : pas de 'grande cause' sans grands moyens" (dont la synthèse est ici). Celui-ci constate "l’impérieuse nécessité de réduire les inégalités territoriales dans l’accès aux soins et de mobiliser l’ensemble des acteurs pour garantir une prise en charge graduée et de proximité aux patients".
Le 9 juillet ensuite, était publié le Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la santé mentale des mineurs, des députées Nathalie Colin-Oesterlé et Anne Stambach-Terrenoir. Parmi ces recommandations, ces dernières appellent à renforcer la coordination des acteurs dans les territoires à travers les PTSM et les CLSM, avec un focus sur la nécessité de développer des partenariats entre les CLSM et les Maisons des adolescents ou encore d'intégrer les professionnels de santé de l'Education nationale, comme les psychologues, les médecins, les infirmiers, au sein des instances des CLSM.
Le 10 juillet enfin, était publié le Rapport d’information sur l’évaluation de la prise en charge des troubles psychiques des personnes placées sous-main de justice des députées Josiane Corneloup et Élise Leboucher. Les élues y formulent 100 préconisations pour sortir de cette impasse sanitaire et sécuritaire (consultez la synthèse).
|
 Pour une refondation de la psychiatrie française, les 48 propositions de l’Unafam Pour une refondation de la psychiatrie française, les 48 propositions de l’Unafam
Le 10 juillet, l’Unafam a présenté au ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, Yannick Neuder, ses 48 propositions pour une refondation de la psychiatrie en France. Après son manifeste pour l’abolition de la contention, qui figure au nombre des propositions, l’Unafam livre cette contribution qui s’organise autour de trois axes : Agir précocement ; Promouvoir le rétablissement pour tous ; Rendre effectifs les droits.
|
 Campagne 2025/2026 des appels à projets de recherche appliquée en santé du Ministère de la Santé Campagne 2025/2026 des appels à projets de recherche appliquée en santé du Ministère de la Santé
Dans sa a note d’information publiée au Bulletin officiel, la Direction générale de l'offre de soins fixe le cadre de 8 appels à projets (APP) soutenant la recherche. Ces AAP irriguent les 5 grands programmes ministériels de recherche appliquée en santé : Recherche translationnelle en santé (PRT-S et PRT-K) ; Recherche clinique hospitalière (PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I) ; Recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ; Recherche médico-économique (PRME) ; Recherche sur la performance du système de soins (PREPS).
5 thématiques sont identifiées comme prioritaires pour cette campagne : Santé mentale et psychiatrie ; Prévention ; Pédiatrie et santé de l’enfant (incluant la pédopsychiatrie) ; Santé des femmes ; Accompagnement, soins palliatifs et fin de vie. Date limite de dépôt des lettres d’intention pour le PHRC-N, le PHRIP, le PREPS et le PRME : 9 décembre 2025.
Accédez à la note ici.
|
 Une fiche métier de France travail pour les Médiateur / Médiatrice en santé pair Une fiche métier de France travail pour les Médiateur / Médiatrice en santé pair
Les fiches métiers de France travail proposent une description détaillée des métiers : définition, accès à l’emploi, compétences (savoir-faire, savoir-être professionnels et savoirs), contextes de travail, mobilité professionnelle. La dernière parution est consacrée aux médiateurs en santé. Elle regroupe plusieurs appellations, dont celle de médiateur·rice en santé pair.
A lire ici.
|
 3 fiches sur les phases de traitement du trouble de stress post-traumatique 3 fiches sur les phases de traitement du trouble de stress post-traumatique
Le Centre national de ressources et de résilience (Cn2r) a récemment publié trois fiches pratiques à destination des professionnels sur les phases de traitement du trouble de stress post-traumatique. La première fiche porte sur la stabilisation. Elle vise à aider les patients à retrouver un sentiment de sécurité et à gérer les symptômes liés au traumatisme avant d’aborder les expériences traumatiques elles-mêmes. La seconde fiche est sur le traitement des souvenirs traumatiques. Cette deuxième phase aborde directement les souvenirs traumatiques et les réactions émotionnelles qui en découlent. Elle doit permettre au patient de désensibiliser les souvenirs traumatiques, de réguler les émotions associées et de transformer les croyances négatives qui en résultent. La troisième fiche porte sur la consolidation. Cette dernière phase se concentre sur la réintégration et la reconstruction de l’individu après avoir traité les traumatismes. Il s’agit d’aider le patient à retrouver sa place dans le monde extérieur, à rétablir des relations sociales et professionnelles saines et à reconstruire une image de soi plus positive et plus fonctionnelle.
Découvrez les fiches ici.
|
 Dernières analyses de la DRESS sur les données EpiCov Dernières analyses de la DRESS sur les données EpiCov
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié une étude dédiée à la santé mentale à partir des données les plus récentes de l’enquête EpiCov. L’enquête couvre la période 2020-2022 à l’aide d’un panel d’environ 64 000 participants représentatif de la population vivant en France et âgée de 15 ou plus au démarrage de l’enquête. L’étude rend compte de l’évolution de certains indicateurs de santé mentale tels que les syndromes dépressifs et les pensées suicidaires dans cette population ainsi que les difficultés psychosociales chez les mineurs. Des données sur le recours aux soins de santé mentale, les inégalités sociales, l’expérience de discriminations, l’orientation sexuelle ainsi que l’usage des écrans et des réseaux sociaux sont également analysées. L’étude met en exergue certains facteurs liés à la santé mentale dégradée qui se retrouvent notamment chez les femmes âgées de moins de trente ans.
A lire ici.
|
 Injustices, psychiatrie et santé mentale : de la nécessité d’une santé mentale publique basée sur la justice sociale Injustices, psychiatrie et santé mentale : de la nécessité d’une santé mentale publique basée sur la justice sociale
Dans cet article publié dans la revue Médecine & Philosophie "Inégalités & justice sociale", le Dr Boris Nicolle explore les liens entre santé mentale, psychiatrie et justice sociale. Il met en avant la notion de "santé mentale publique" comme grille nécessaire d'analyse et de construction de politiques publiques efficaces, incluant nécessairement la psychiatrie. Il y plaide pour la construction d'une théorie de la justice sociale en santé mentale par la mise en dialogue de la philosophie politique, de l'épistémologie et de la sociologie, en intégrant des travaux plus récents sur la justice épistémique. Il met en lumière les déterminants sociaux à l’œuvre, qui sont autant de cibles pour la prévention et promotion de la santé mentale et la facilitation des parcours de rétablissement des personnes souffrant d’un trouble psychique. Dans une seconde partie, il présente différentes théories de la justice sociale appliquées aux déterminants de la santé, associant approches distributives et théories de la reconnaissance pour décrire l’ensemble des injustices sociales en santé.
A lire ici.
|
 Derniers articles du BEH : anxiété et dépression post-partum Derniers articles du BEH : anxiété et dépression post-partum
Le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France comporte deux articles. Le premier porte sur la prévalence des états anxieux chez les 18-85 ans. Contrairement à l’augmentation observée pour les épisodes dépressifs caractérisés, les résultats ne montrent pas d’évolution significative de la prévalence des états anxieux entre 2017 et 2021. Ils suggèrent cependant une prévalence élevée des états anxieux, associée à de fortes inégalités sociales et à des comorbidités importantes. Le second article porte sur le dépistage de la dépression du post-partum lors de l’entretien postnatal précoce réalisé par les sages-femmes de la Protection maternelle et infantile de l’Hérault. Parmi les femmes chez qui la dépression post-partum (DPP) a été dépistée, près de 3 femmes sur 10 présentaient des signes modérés à majeurs de DPP, 1 femme sur 6 était fortement symptomatique.
A lire ici.
|
 |
 La santé mentale dans toutes les politiques : un article dans le Lancet suite à la conférence de Paris La santé mentale dans toutes les politiques : un article dans le Lancet suite à la conférence de Paris
Suite à la conférence organisée à Paris en juin (voir notre précédente édition), l’article impulsé par l’OMS Europe et publié par The Lancet Psychiatry redonne les enjeux de la déclaration finale de Paris, qui est un appel à l’action. Ce texte, signé par les nombreux ministres présents, réaffirme la nécessité de rendre opérationnel le concept de santé mentale dans toutes les politiques et souligne comment la coopération entre secteurs et entre ministères peut et doit contribuer à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques plus efficaces et optimisant les ressources pour améliorer la santé mentale. Mais cela ne doit pas rester une liste de vœux pieux à la seule main des décideurs politiques. La société civile doit être en mesure de demander aux gouvernements locaux et nationaux de rendre compte de l’intégration de la santé mentale dans toutes les politiques afin de répondre aux multiples besoins des personnes (soin, accompagnement, accès au logement, formation et emploi, sport, culture…). Plusieurs exemples d’actions dans différents pays sont cités dans l’article.
Téléchargez la version française ici.
|
 OMS : un nouveau document de référence sur l’intégration des experts d’expérience OMS : un nouveau document de référence sur l’intégration des experts d’expérience
La nouvelle feuille de route de l'OMS intitulée "Transformer la santé mentale grâce à l'expérience vécue : une feuille de route pour l'intégration des praticiens issus de l'expérience vécue dans les politiques, les services et les communautés de santé mentale", peut servir de guide aux pays pour intégrer officiellement les personnes ayant une expérience vécue dans les systèmes et services de santé mentale, en fournissant des mesures concrètes pour leur inclusion significative et en promouvant des services de santé mentale inclusifs, humanisés et axés sur le rétablissement. Le document détaille les questions de cocréation, de collaboration et d'intégration, donne des arguments sur la nécessité de normaliser la formation et la certification, d’améliorer la supervision et le soutien, ou encore d’élargir l'accès aux experts d’expérience grâce à des outils accessibles et numériques. Le document comporte de nombreuses études de cas (dont le programme Médiateurs de santé pairs du CCOMS), des publications et textes de référence sur le sujet. Cette feuille de route est envisagée comme la première étape d'un processus en trois phases. Les phases 2 et 3 se concentreront sur la co-création et le pilotage d'un programme de formation certifié/accrédité à l'échelle européenne pour l'intégration de l'expérience vécue dans les systèmes de santé mentale.
A lire ici (en anglais).
|
 De la solitude aux liens sociaux : ouvrir la voie vers des sociétés plus saines De la solitude aux liens sociaux : ouvrir la voie vers des sociétés plus saines
La Commission de l'OMS sur les liens sociaux a publié un rapport qui montre les répercussions graves, et sous-estimées, de l'isolement social et de la solitude sur la santé, le bien-être et la société. La Commission a défini ces problèmes comme un "troisième pilier de la santé", aux côtés de la santé mentale et physique. Le document révèle qu’une personne sur six dans le monde souffre de solitude. Bien que des personnes de tous les groupes d’âge et de toutes les régions du monde soient touchées par la solitude, celle-ci est plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes (environ 1 sur 5, 1 sur 4 pour les adolescentes de 13-17 ans) et dans les pays à faible revenu (près d’une personne sur 4). De nouvelles estimations suggèrent que la solitude est responsable d'environ 871 000 décès par an, soit environ 100 décès par heure. 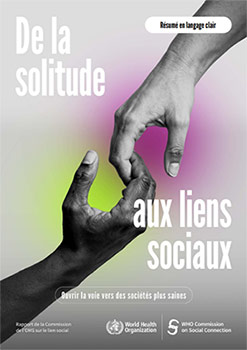 L'isolement social et la solitude ont de graves répercussions sur la mortalité, la santé physique (par exemple, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2) et la santé mentale (par exemple, la dépression et l'anxiété). Les coûts économiques pour les employeurs, les systèmes de santé et les individus sont considérables etcommencent seulement à être estimés. Les causes de l'isolement social et de la solitude identifiées dans le rapport incluent les technologies numériques, les faibles revenus et le faible niveau d'éducation, les problèmes de santé chroniques, la solitude, l'absence de communauté et de réseaux d'amitié. L’époque est donc techniquement la plus connectée de l’histoire, mais paradoxalement celle où la solitude est importante, particulièrement chez les jeunes. Enfin, le rapport met en avant des solutions prometteuses pour réduire l’isolement social et la solitude : plaidoyer, campagnes, réseaux et coalitions, politiques, stratégies communautaires, stratégies individuelles et relationnelles. L'isolement social et la solitude ont de graves répercussions sur la mortalité, la santé physique (par exemple, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2) et la santé mentale (par exemple, la dépression et l'anxiété). Les coûts économiques pour les employeurs, les systèmes de santé et les individus sont considérables etcommencent seulement à être estimés. Les causes de l'isolement social et de la solitude identifiées dans le rapport incluent les technologies numériques, les faibles revenus et le faible niveau d'éducation, les problèmes de santé chroniques, la solitude, l'absence de communauté et de réseaux d'amitié. L’époque est donc techniquement la plus connectée de l’histoire, mais paradoxalement celle où la solitude est importante, particulièrement chez les jeunes. Enfin, le rapport met en avant des solutions prometteuses pour réduire l’isolement social et la solitude : plaidoyer, campagnes, réseaux et coalitions, politiques, stratégies communautaires, stratégies individuelles et relationnelles.
Outre le rapport complet en anglais, consultez, en français, le résumé, rédigé à l'intention d'un large public, et le communiqué de l’OMS.
|
 Suicide dans le monde : dernières estimations de l’OMS Suicide dans le monde : dernières estimations de l’OMS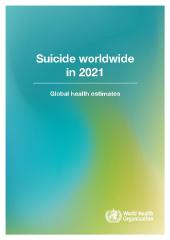
Dans le dernier rapport de l’OMS sur le suicide publié au début de l’été, on estime que 727 000 personnes se sont suicidées en 2021 dans le monde. Le suicide était la troisième cause de décès chez les 15-29 ans ; deuxième chez les femmes, troisième chez les hommes. Plus de la moitié des suicides dans le monde (56 %) ont eu lieu avant l'âge de 50 ans, et la majorité des suicides ont eu lieu dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (73 %). Ce document s’adresse aux gouvernements, décideurs politiques, agences de développement, professionnels de santé, universitaires, chercheurs, organisations non gouvernementales, journalistes/médias et le grand public. Il comporte des statistiques par grandes régions et également par pays.
A lire ici (en anglais).
|
 |
   
|
Retrouvez les 10 précédentes éditions de la Lettre du GCS ici.
Copyright © 2025, tous droits réservés.
La Lettre du Groupement de coopération sanitaire pour la recherche et la formation en santé mentale est éditée par le Centre collaborateur de l'OMS (CCOMS), service de l’EPSM Lille métropole. Le GCS a pour objet la recherche, la formation et la mise en œuvre d’actions visant le développement de dispositifs de santé mentale intégrés dans la cité, incluant la prévention et l’insertion des publics souffrant de troubles mentaux. Le Groupement œuvre à la promotion des échanges professionnels et à toute action de lutte contre la stigmatisation en santé mentale et en psychiatrie. Il favorise et soutient la participation des représentants des usagers, des familles et des aidants. Le GCS, dont le conseil scientifique est celui du CCOMS de Lille, relaie les recommandations de l’OMS au niveau national et localement.
Pour éviter que nos communications soient considérées comme des courriers indésirables par votre messagerie, nous vous invitons à ajouter l'adresse adannet@gcs-epsm-lille-metropole.fr à votre carnet d'adresses.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant que vous pouvez exercer en envoyant un e-mail à alain.dannet@ghtpsy-npdc.fr.
Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
|
|

 Nous apprenons les uns des autres grâce à l’échange de pratiques. EUCOMS compte plus de 30 services membres, de la Norvège au Portugal et de l’Irlande à l’Ukraine. Nous organisons deux rencontres par an en Europe, qui nous permettent d’effectuer des visites d’étude et de découvrir comment les services fonctionnent en pratique. En plus de ces rencontres, nous organisons 4 webinaires par an sur un thème spécifique à la santé mentale dans la communauté. Chacun d’entre eux est introduit et conclu par des experts d’expérience et des performances musicales en live. Enfin, nous éditons une newsletter mensuelle."
Nous apprenons les uns des autres grâce à l’échange de pratiques. EUCOMS compte plus de 30 services membres, de la Norvège au Portugal et de l’Irlande à l’Ukraine. Nous organisons deux rencontres par an en Europe, qui nous permettent d’effectuer des visites d’étude et de découvrir comment les services fonctionnent en pratique. En plus de ces rencontres, nous organisons 4 webinaires par an sur un thème spécifique à la santé mentale dans la communauté. Chacun d’entre eux est introduit et conclu par des experts d’expérience et des performances musicales en live. Enfin, nous éditons une newsletter mensuelle."


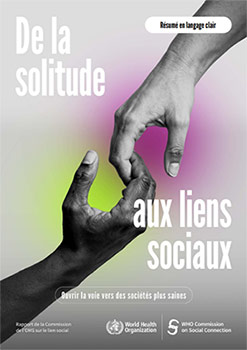 L'isolement social et la solitude ont de graves répercussions sur la mortalité, la santé physique (par exemple, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2) et la santé mentale (par exemple, la dépression et l'anxiété). Les coûts économiques pour les employeurs, les systèmes de santé et les individus sont considérables etcommencent seulement à être estimés. Les causes de l'isolement social et de la solitude identifiées dans le rapport incluent les technologies numériques, les faibles revenus et le faible niveau d'éducation, les problèmes de santé chroniques, la solitude, l'absence de communauté et de réseaux d'amitié. L’époque est donc techniquement la plus connectée de l’histoire, mais paradoxalement celle où la solitude est importante, particulièrement chez les jeunes. Enfin, le rapport met en avant des solutions prometteuses pour réduire l’isolement social et la solitude : plaidoyer, campagnes, réseaux et coalitions, politiques, stratégies communautaires, stratégies individuelles et relationnelles.
L'isolement social et la solitude ont de graves répercussions sur la mortalité, la santé physique (par exemple, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2) et la santé mentale (par exemple, la dépression et l'anxiété). Les coûts économiques pour les employeurs, les systèmes de santé et les individus sont considérables etcommencent seulement à être estimés. Les causes de l'isolement social et de la solitude identifiées dans le rapport incluent les technologies numériques, les faibles revenus et le faible niveau d'éducation, les problèmes de santé chroniques, la solitude, l'absence de communauté et de réseaux d'amitié. L’époque est donc techniquement la plus connectée de l’histoire, mais paradoxalement celle où la solitude est importante, particulièrement chez les jeunes. Enfin, le rapport met en avant des solutions prometteuses pour réduire l’isolement social et la solitude : plaidoyer, campagnes, réseaux et coalitions, politiques, stratégies communautaires, stratégies individuelles et relationnelles.